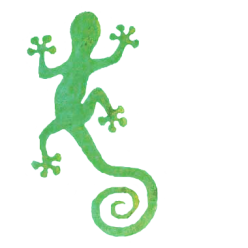Voici donc un nouveau départ vers l’ailleurs.
Première étape, l’arrivée, précédée par un vol éprouvant, Anne-Marie coincée contre un ancien truand marseillais dépassant le quintal et demi, drapé dans un survêtement de l’OM. De mon côté, je me suis battu une partie de la nuit pour l’accoudoir avec un malgache mutique, notre conversation s’étant limitée à tchin-tchin, quand nous avons levé nos verres de Red Label, au moment du repas. Lui a regardé toute la nuit des films sous-titrés. Il n’avait pas d’écouteurs.
Descendus de l’avion, les passagers sont rangés sur trois files, la notre étant celle de l’ambassade. Après avoir bien pris le soleil sur le tarmac, direction la prise de température automatique. Pour Anne-Marie, l’appareil n’a pas pu fonctionner, elle est mise de côté. Ensuite passage dans un sas de décontamination intelligent. C’est écrit sur la porte.
Je fais la queue aux passeports, où Anne-Marie finit par me rejoindre sans qu’elle ne soit passée par le sas de décontamination. Le fonctionnaire détache les différents volets du document que nous avons rempli, il y en a quatre, et nous en rend un. Passage dans un tout petit salon où doit se dérouler le test PCR. Pas plus de trois en principe, mais on est six, plus le médecin et trois infirmières. Les autres attendent dehors.
A un moment le médecin sort, il n’a plus de test. Il revient avec quatre militaires bien décidés à faire accélérer les choses, remplissant les formulaires, mais la barrière de la langue n’aide pas. On veut me faire remplir un deuxième formulaire alors que je suis en train de me faire grattouiller le nez par le médecin. Il n’a pas cherché loin et n’a testé qu’une narine. Ça chatouille le nez. C’est au tour d’Anne-Marie, qui doit répondre à l’appel de son nom alors que le médecin lui triture le nez. Maintenant, elle tient l’écouvillon que lui a remis le médecin après le test et se demande bien qu’en faire. Une infirmière l’en débarrasse.
On sort, laissant dans le salon une pile de feuilles sur la table et un carton plein de petits sachets. Bon courage à celui qui fera le tri. Passage au visa et tampon rouge. Important le tampon. On récupère les bagages, on sort en file indienne, les bagages sont à nouveau désinfectés, puis jetés sur les toits des bus qui nous attendent. Il y a des gendarmes partout, le périmètre est sécurisé.
On partira en convoi jusqu’à l’hôtel, où nous resterons confinés. On pourrait être dans n’importe quelle ville de France, sauf qu’on y mange bien et que la vue est déroutante. Une lampe ne marchant pas, on nous a envoyé un cosmonaute pour la changer.
Pas question ici d’apéro dans les chambres ni de discussions dans les couloirs. J’ai le temps d’écrire, alors j’en profite. A côté, Anne-Marie fait du Yoga dans les rayons du soleil couchant.
Partager la publication "Le passage de la ligne"