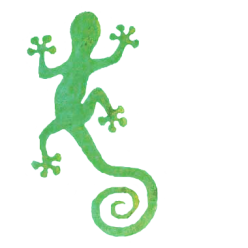Après avoir passé du temps sur les correspondances de mes grands-parents ardéchois, je suis allé à la recherche des paysages qui les ont façonnés. Ils étaient de la ville, Vals, petit bourg vivant du ver à soie et des curistes, Privas, la préfecture, avec ses rues, ses places, ses châtaignes. J’ai choisi les villages aux rues étroites, les calades, les plateaux déserts.

On y saisit tout ce qui fit la rigueur de leur jeunesse, la nature rugueuse et l’histoire sanglante de cette terre marquée par les guerres de religion. Les curés quasi illettrés qui remplissaient les registres après que les pasteurs eurent été chassés. De cette histoire, il n’en reste rien aujourd’hui, sinon des croix et des chapelles partout. Et quelques ruines dans les hauteurs, telles ces habitations troglodytes au-dessus de Privas, refuges pour les protestants privadois.

Je n’ai pas trouvé ce que j’étais venu y chercher, mais j’en suis revenu plus riche de ce passé. En particulier celui de Marie Durand, d’une famille protestante, embastillée à l’âge de dix-huit ans à Aigues-Mortes, dans la tour de Constance, d’où elle sortira trente-huit ans plus tard pour venir finir ses jours dans la maison familiale, sur le plateau ardéchois. La maison est belle, site classé et musée du Vivarais protestant aujourd’hui.

A sa mort, à soixante-cinq ans, elle laissera outre la maison, une paillasse et trois coffres. Son mari a disparu, son frère a été pendu à trente ans à Montpellier.

Ce pays cimetière rural est bien calme.